Les marchés publics c'est quoi ?

Le marché public c'est quoi ?
Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux passés par une personne publique (appelé « acheteur public ») avec une personne publique ou privée (appelé « opérateur économique ») pour répondre à ses besoins de travaux, fournitures ou services.
Les règles concernant les marchés publics sont fixées par le Code de la commande publique.
Les différents types de marchés publics
Il existe plusieurs types de marchés publics :
- Marchés publics de travaux pour l'exécution des travaux de bâtiment, de génie civil ou d'infrastructure,
- Marchés publics de fournitures nécessaires au fonctionnement de l'administration avec achat de produits, de matériels, ou location,
- Marchés publics de services pour la réalisation de prestations de services matériels (par exemple : nettoyage de locaux) ou immatériels (prestation intellectuelle comme la maîtrise d'œuvre).
Ces marchés peuvent porter sur des travaux, fournitures ou services nouveaux, ou améliorer une méthode de commercialisation (promotion, tarification d’un produit...), une organisation, une pratique ou des relations.
Ils répondent à de nouveaux besoins de l’administration, permettent d'améliorer un besoin existant ou bien d’un concept nouveau.
Les règles applicables varient en fonction du type de marché. Par exemple, le montant du marché détermine la mise en place d'une procédure plutôt qu'une autre.
Les contrats des marchés publics
Les marchés conclus peuvent prendre les formes suivantes :
- Marché à quantité fixe (ou marché ordinaire) : est utilisé lorsque les éléments déterminants sont connus (durée, quantité, caractéristiques techniques…), et qu'il n'existe aucune incertitude sur le rythme d'exécution des prestations ou sur les quantités dont l'acheteur aura besoin.
- Marché à bons de commande : il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Les caractéristiques techniques sont précisées dans le cahier des charges mais il existe une incertitude sur les quantités exactes dont l’acheteur aura besoin et/ou le rythme d’exécution des prestations.
- Marchés fractionnés (ou accords-cadres) : lorsque l'acheteur ne peut pas définir précisément le besoin, l'accord-cadre fixe les marchés à passer au cours d’une période donnée, avec les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Par exemple, le marché porte sur l'achat de matériel informatique pendant une durée de 3 ans, avec plusieurs prestataires. Une remise en concurrence des titulaires sera effectuée avant chaque marché.
Qui peut se porter candidat à un marché public
Les marchés ouverts à tous
En principe, toute entreprise peut se porter candidate, quelle que soit sa forme juridique (entrepreneur individuel ou société) ou quelque soit sa taille (micro-entrepreneur, TPE, PME). Plusieurs entreprises peuvent s'associer pour répondre à un marché public.
L'entreprise doit remplir plusieurs conditions pour être admise à se porter candidate :
- Elle ne doit pas avoir été condamnée lors des 5 dernières années,
- Elle doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales,
- Elle ne doit pas être en procédure de liquidation judiciaire.
Les personnes pouvant répondre à un marché public sont nommées de la façon suivante :
- Lorsque la procédure de concurrence est à son début, on parle d'opérateur économique,
- Le candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à la procédure,
- Le soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public.
Les marchés réservés
Certains marchés publics sont réservés à des structures (dites aussi « entreprises inclusives ») employant des personnes handicapées, défavorisées, détenues ou éloignées de l’emploi dans des proportions plus importantes que les entreprises classiques.
La proportion minimale de ces catégories de personnes employés est fixée à 50 %.
Les structures concernées par ces marchés sont les suivantes :
- Entreprises adaptées (EA) et établissements,
- Établissements et services d’aide par le travail (ESAT),
- Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) accompagnant les personnes défavorisées,
- Entreprises implantées en établissement pénitentiaire : la production de biens et services est réalisée en établissement pénitentiaire par des personnes détenues,
- Entreprises de l'économie sociale et solidaire (EESS).
La mise en concurrence ne s'exerce qu'entre les structures d'insertion.
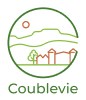
 Moyen
Moyen