Le Maire Ernest Brochier

Monsieur Ernest Brochier, né le 4 mars 1887 à Coublevie, fut premier adjoint sous la municipalité de M. Perrot Berton, Maire entre 1940 et 1941.
Selon les comptes-rendus des conseils municipaux, il apparaît comme Maire après le décès de M. Perrot Berton à partir de mars 1942. A cette époque il n’y avait pas d’élections, mais nous supposons qu’il fut désigné par vote du conseil municipal.
Témoignage de son fils Hubert
« Après le discours du Maréchal Pétain le 30 octobre 1940, mon père se précipita immédiatement du côté de la Résistance et du Gaullisme. Par son poste de Maire, il tenta de résoudre les divers problèmes que posait l’occupation d’un petit village par une troupe ennemie victorieuse et cherchant à célébrer sa victoire ; mais c’était encore le temps où l’on disait que les Allemands étaient « corrects ».
 Mon père, plus que jamais gaulliste et persuadé que la guerre ne pouvait être gagnée que par les Alliés, vivait sans trop craindre la police, à peu près absente dans notre campagne, mais beaucoup plus de la Milice dont le chef voironnais était Jourdan, un de ses anciens camarades de classe qu’il avait rencontré à plusieurs reprises depuis juin 1940, et auquel il n’avait guère caché ses sentiments. Malgré les exactions attribuées à Jourdan, mon père pensait cependant qu’il n’avait rien à craindre de lui. Dans ses fonctions de répartiteur du bétail à abattre, comme dans les visites qu’il faisait à ses clients, mon père parlait assez librement, après avoir tâté le terrain, de la guerre et des évènements locaux. Lorsqu’il estimait que son interlocuteur pensait comme lui, il devenait beaucoup moins discret, ce qui n’était guère prudent ! En revanche, il ne mettait personne – pas même ma mère ou moi – au courant de ses activités illégales : faux papiers ou carte d’alimentation.
Mon père, plus que jamais gaulliste et persuadé que la guerre ne pouvait être gagnée que par les Alliés, vivait sans trop craindre la police, à peu près absente dans notre campagne, mais beaucoup plus de la Milice dont le chef voironnais était Jourdan, un de ses anciens camarades de classe qu’il avait rencontré à plusieurs reprises depuis juin 1940, et auquel il n’avait guère caché ses sentiments. Malgré les exactions attribuées à Jourdan, mon père pensait cependant qu’il n’avait rien à craindre de lui. Dans ses fonctions de répartiteur du bétail à abattre, comme dans les visites qu’il faisait à ses clients, mon père parlait assez librement, après avoir tâté le terrain, de la guerre et des évènements locaux. Lorsqu’il estimait que son interlocuteur pensait comme lui, il devenait beaucoup moins discret, ce qui n’était guère prudent ! En revanche, il ne mettait personne – pas même ma mère ou moi – au courant de ses activités illégales : faux papiers ou carte d’alimentation.
En 1943, j’étais au collège de Chambéry, je sortais peu, de peur des contrôles. Par prudence je ne correspondais pas avec mes parents. Mi-décembre, je reçus la visite du père Aubé, venu de Grenoble pour m’annoncer l’arrestation de mon père et me demander de renoncer à tout projet d’aller à Coublevie pour les vacances de Noël. D’après ce qui m’a été raconté par la suite, voici comment les choses s’étaient passées.
Le 3 décembre dans l’après-midi, peu avant 18 heures, mon père était allé chez le coiffeur du Bérard. Il n’avait pas de sympathie marquée pour ce coiffeur, dénommé Philibert, garçon barbu d’apparence molle et asexuée, dans un salon à l’équipement rudimentaire et pas très net. C’est là que se présentèrent trois sbires de la police allemande vêtus de leurs inévitables manteaux de cuir. Ils demandèrent : « Où est la maison de M. Brochier, le Maire ? » et mon père, dans un mouvement spontané, leur dit : « Monsieur Brochier, c’est moi ». Ils l’embarquèrent immédiatement dans leur voiture en direction de la maison, où ils entreprirent une perquisition violente et désordonnée en présence de ma grand-mère et de mon frère Jacques, alors âgé de 14 ans et qui revenait de l’école toute proche installée au couvent des Dominicains.
On m’a raconté qu’ils furent vertement rabroués par la vieille femme, ma mère étant absente ; dans leur discours, revenait le terme de « terroriste ». Mon père était un terroriste ou aidait les terroristes, accusations équivalentes pour la police allemande de l’époque.
La raison de l’incarcération de mon père est sans doute liée aux évènements qui s’étaient produits à Grenoble depuis le 11 novembre et qui avaient littéralement enragé les Allemands. Ce jour-là, une manifestation de résistants avait eu lieu devant le monument aux “Diables Bleus” et les occupants avaient déporté 450 personnes. En riposte, les corps francs des Mouvements unis de la Résistance firent sauter, dans la nuit du 13, le parc d’artillerie de la garnison allemande. Une nouvelle fournée d’otages fut alors exécutée. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, grâce à la complicité d’un soldat polonais incorporé de force dans la Wehrmacht, la Résistance put faire exploser la caserne de Bonne tout entière, faisant plus de 50 tués et 200 blessés Allemands. Saisis de rage, les Allemands déportèrent massivement un grand nombre d’hommes et de femmes jugés proches de la Résistance, et à commencer par le docteur Valois, chef de la Résistance de l’Isère.
Ou bien, - et c’est plutôt le sentiment de mon frère – son arrestation était due à une dénonciation de Jourdan. En tous cas, les miliciens voironnais ou d’autres délateurs bien informés avaient été, peu de temps auparavant, à l’origine d’évènements qui avaient bouleversé ma famille, car ils concernaient des amis très proches. La police allemande était venue en effet, arrêter M. Lefrou, ancien militaire, grand résistant, mais un peu bavard ; ne l’ayant pas trouvé à son domicile, elle avait pris en otage, puis gardé en détention sa femme. Celle-ci, libérée au bout de trois semaines, était revenue à Coublevie épuisée après avoir été sévèrement torturée. Mais avec un grand courage, elle se taisait, et a toujours refusé de parler de ce qu’elle avait subi. Mes parents avaient été très affectés par cet évènement, qui avait suscité chez mon père de sombres pressentiments, et depuis le retour de Mme Lefrou, répétait fréquemment devant ma mère et mon frère : « Cette semaine, c’est pour moi ». Cet épisode éclaire tout spécialement l’attitude de mon père au moment de son arrestation ; il ignorait, comme tout le monde en France à ce moment-là, ce qu’étaient réellement les camps de concentration, et les conditions atroces de la détention des prisonniers.
Il commença donc immédiatement le long périple qui devait le mener à Buchenwald. Ma mère rentrant de courses après le départ de mon père et de ses gardiens, chercha immédiatement à le revoir. Elle apprit qu’il était gardé à la gendarmerie de Voiron, seul local de police des environs qui pouvait servir de prison provisoire. Elle s’y précipita, avec l’espoir insensé que les gendarmes allaient lui laisser libre accès à son mari et qui sait, peut-être, faciliter son évasion. Mais ils restèrent intraitables et muets, sachant bien qu’ils répondaient du prisonnier sur leur vie, ou au prix de représailles plus cruelles encore. Ma mère ne réussit donc qu’à faire passer au prisonnier une montre en or que, dans son ignorance elle considérait comme monnaie d’échange.
A partir de là, ma mère qui vivait cette situation dans une grande solitude, multiplia auprès d’amis et fit diverses tentatives officieuses et officielles pour empêcher ou retarder la déportation de son mari.
Deux de ces démarches méritent d’être citées. La première émanait d’un ami de papa qui, ému par la nouvelle de son arrestation, accourut de Marseille et se fit fort d’intervenir auprès d’un commandant Allemand, qui était une de ses relations. Il le fit en effet, mais l’officier ne put ou n’osa pas intervenir auprès de la Gestapo. La seconde, plus étonnante encore, fut sur le point de réussir : les pères Chartreux de Coublevie, offrirent de toucher le supérieur général des Chartreux, dom Bernard Chastenet de Géry, qui était allé en Espagne, au cours de sa carrière d’officier, le condisciple du maréchal Goering en personne ! Cette démarche semble avoir eu quelque effet, en ce sens que Goering avait accepté l’idée de faire relâcher mon père, mais ses ordres arrivèrent trop tard ; mon père était déjà parti en convoi pour un camp de concentration et les recommandations du maréchal du Reich restèrent lettre morte.
Pendant ce temps, ma mère se rendit plusieurs fois à Lyon pour tenter de voir son mari au fort Monluc : elle reçut même, vers la fin décembre, un formulaire de la prison qui lui demandait d’apporter dans une valise un cache-col, un morceau de savon, un peigne... Mon père n’avait pu ajouter que ses vœux de Noël et d’infinies tendresses à tous.
Au début 1944, ma mère apprit qu’il se trouvait au camp de Compiègne. La déportation de mon père ne fut une certitude qu’au début du mois d’avril 1944, à la réception d’une lettre expédiée par lui du camp de Weimar-Buchenwald, à la date du 26 mars. Cette lettre écrite en Allemand sur un lugubre formulaire de papier jaunâtre, n’était pas de sa main, mon père ne parlait pas Allemand et il avait dû avoir recours à un camarade de captivité. Sa signature, bien reconnaissable, l’authentifiait pourtant, de même que nombre de détails ou de demandes qui ne pouvaient provenir que de lui. Cette lettre, sinistre, commençait par le règlement du camp, et était parsemée de diverses mentions impératives, elle était revêtue du tampon de la censure. Il nous demandait d’envoyer des colis ; c’était lebensnötig, ce que notre traducteur bénévole traduisait par nécessaire vital, autrement dit, une question de vie ou de mort. Mon père devait être littéralement mort de faim, car il demandait de lui faire envoyer des colis par la mairie et aussi par les sœurs de Beauregard, religieuses « à qui il avait rendu de grands services » écrivait-il.
Ce fut un rude choc pour ma mère d’apprendre que son mari était dans un camp de concentration allemand, mais le soulagement de le savoir vivant l’emporta, et celui de pouvoir communiquer avec lui et le secourir par l’envoi de quelques vivres. Aussitôt commencèrent pour elle l’interminable recherche des aliments et vêtements autorisés et les démarches auprès de la Croix-Rouge et autres organismes officiels habilités à envoyer des colis aux prisonniers.
A la lecture de la première lettre de mon père, les atrocités qui se passaient dans le camp dépassaient notre imagination. Les quatre lettres que nous avons reçues de lui (la dernière étant datée du 26 juin 1944) se ressemblent étrangement, il est essentiellement questions des colis attendus et reçus, des denrées à envoyer ou à ne pas envoyer, d’interdictions diverses : pas d’argent, ni de photos, de reconnaissance pour l’amour et le courage, et des vœux à transmettre à tous, parents et amis.
Dans sa lettre du 21 mai, cependant, mon père semble particulièrement préoccupé par ce qu’il se passe à Coublevie. Il demande que mon frère n’aille plus à l’école mais reste à la maison ; il met fin à l’espoir de ma mère d’en apprendre un peu plus sur sa vie de prisonnier par une phrase définitive « De ma vie, je ne peux rien te dire ; donc tu n’as besoin de rien me demander ». Mais en même temps il nous fait comprendre qu’il a appris ce qui est arrivé à son pire ennemi et ancien condisciple de collège, le chef de la milice Jourdan, assassiné par deux élèves de l’Ecole nationale technique de Voiron. « J’ai entendu dire que le mois d’avril a été orageux et que la foudre est tombée sur une villa non loin de l’école ». (En effet le 20 avril quatre élèves de l’Ecole professionnelle de Voiron exécutent Jourdan, le chef de la Milice de Voiron, deux miliciens et assassinent la mère, la femme et les deux enfants de Jourdan ; deux des meurtriers et un surveillant de l’école sont condamnés à mort par la Cour Martiale et exécutés, le 3 mai à Lyon en présence d’une vingtaine de professeurs et d’élèves de l’école qui seront, eux, déportés).
Dans sa dernière lettre, postérieure au débarquement, il se préoccupe des difficultés que pourrait rencontrer ma mère pour l’acheminement des colis et lui enjoint de ne plus en envoyer « si le ravitaillement de la maison doit en souffrir ». Ce seront les derniers mots de lui qui nous parviendront directement, puisqu’à cette date, le débarquement allié en Normandie a déjà eu lieu et que, bientôt, on ne pourra plus correspondre à travers les lignes du champ de bataille.
Dès le débarquement de Normandie, nous sommes saisis comme tous les Français d’une impatience grandissante et, désormais, toutes nos attentes sont tournées vers le but unique. En quelques mois, les armées alliés vont réussir à libérer le pays. Le 25 août, les armées françaises et américaines débarquées sur la côte méditerranéenne, entreront à Grenoble, au même moment où l’on entend à la radio les cloches de Paris saluant à toute volée la libération de la Capitale. Ces moments sont chargés d’une émotion formidable. Nous avons l’impression que les Alliés vont, du même élan, déferler en Allemagne et conclure la guerre, mais nous nous trompions. Il faudra encore de longs mois avant que les armées hitlériennes ne soient définitivement défaites. Ce sera fait, comme chacun le sait, en mai 1945, et à ce moment-là s’ouvrira pour nous une nouvelle et longue période d’attente.
A partir d’avril 1945, nous attendions mon père tous les jours. Le premier indice qui nous arriva fut une carte postale d’un de ses amis du camp, André Curtet, postée à Mulhouse le 25 mai : « Mon bien cher Monsieur Brochier, Rentré dans notre pauvre mais douce France depuis ce matin, ma première pensée est pour vous. J’ai grande hâte de savoir ce que vous êtes devenu, mais vous espère en bonne santé, et, plus heureux que moi, rentré depuis longtemps. J’en ai vu de toutes les couleurs depuis mon départ précipité de Buchenwald du 7/04 de grand matin. Après de grandes souffrances dans un train fantôme, en wagons découverts, j’ai vu abattre Muret à bout portant, moi-même je suis le fusillé n° 4, mais grâce à Dieu et à ma présence d’esprit, je suis encore de ce monde. J’accuse 34 kilos de déchet aujourd’hui ! Il était moins une lorsque les Ruskys sont venus à Kaplitz, en Autriche. J’étais à bout de souffle ! Enfin ce cauchemar est fini. Vite de vos nouvelles et bientôt j’irai vous embrasser à Coublevie... ». Cette carte fut suivie, quelques jours après, de la visite d’André Curtet à Coublevie, où il nous raconta les terribles moments qu’il avait vécus un mois auparavant, avec mon père, et nous dit tout espoir de le revoir bientôt en liberté. D’autres nouvelles étaient plus alarmantes encore : on nous apprit que, pendant quelques semaines au moins, mon père avait déliré à la suite de coups de pelle qu’il avait reçus sur la tête. Un autre déporté nous a dit qu’il avait perdu sa prothèse oculaire et souffrait beaucoup de son œil.
Puis, pendant des semaines et des mois, nous restâmes sans nouvelles. Les retours des déportés ayant pris fin, la mort de mon père apparaissait de plus en plus probable. Ma mère fit toutes les démarches possibles auprès du ministère des Anciens Combattants et victimes de guerre, des mouvements de Résistance à Grenoble, de la Croix-Rouge... sans obtenir aucune information précise. Enfin, au terme d’une longue enquête auprès de ses camarades de bloc, nous eûmes des renseignements sur les derniers jours de mon père. Extrait de la lettre d’un de ses meilleurs camarades J. Garcier :
« Le 8 avril 1945, il prit le même convoi que moi, que l’on appela convoi d’extermination, en direction de Flossenburg. Nous prîmes le chemin de fer dans des wagons découverts à raison de 90 hommes en moyenne jusqu’à Dachau. De là, nous primes la route pour Flossenburg, elle fut d’ailleurs un long calvaire, nous la fîmes en deux étapes. Ensuite on resta trois jours au camp et c’est là que je retrouvai M. Brochier, très affecté et très fatigué. En quittant le camp, on toucha un quart (de litre) de seigle cru pour toute nourriture, et ce fut à nouveau la route, hélas très longue et combien pénible ! On nous fit marcher, marcher encore, toujours en très longues étapes, coucher dans l’eau, sans nourriture sous la pluie. Je donnais le bras à M. Brochier et à l’avant-dernière étape, il me dit textuellement ces paroles : mon cher Garcier, ton pull-over m’a sauvé la vie, sans toi je serais mort de froid. Je lui dis que j’en étais bien heureux et nous continuâmes à marcher jusqu’à l’arrêt. Le lendemain, nous repartions et il était complètement désemparé, je le remontai de mon mieux, mais rien à faire. Il me dit qu’il avait reçu une pièce d’or et qu’on la lui avait volée ; de plus, il avait son dentier cassé, et malgré mes encouragements, il me dit ce jour-là qu’il était perdu et qu’il ne reverrait plus sa famille. Là, j’ai compris que, malgré tout ce que je pouvais faire, je n’aurais pas la joie de le ramener en France, car il était dans un état de complet épuisement. Je le ramenai malgré tout jusqu’à l’étape où ce fut encore une nuit terrible, couchés dans l’eau sous une pluie diluvienne. Il se coucha à côté de moi, et malgré l’eau, je m’endormis. Quand je me réveillai, mon ami avait disparu. Comment ? Je ne sais pas, je ne le revis jamais plus. Je puis vous certifier, Madame, que mon malheureux ami est décédé. J’en suis sûr ». Suit une description détaillée de la manière dont mon père était vêtu et notamment du fameux pull-over qui lui avait -presque- sauvé la vie.
La lettre se termine par le post-scriptum suivant : « M. Brochier est disparu dans la nuit du 21 au 22. Le 23 nous étions libérés en Bavière, à Unterberland, à 7 km de Cham par la division cuirassée américaine ». On a l’impression que les SS qui dirigeaient le convoi cherchaient surtout à fuir l’avancée des Russes, et pour le reste, allaient un peu au hasard. Cette dernière épreuve fut pour les déportés, particulièrement cruelle : ils parcoururent 140 km à pied avec environ 400 g de pain et un litre de seigle en grains. Les camarades qui mouraient d’épuisement, nous écrivit l’un d’eux, étaient laissés sur la route, la colonne continuant sa marche et nous n’avions pas le droit de nous arrêter pour identifier les victimes. Un groupe de déportés, désignés et encadrés par les SS, enterrait nos malheureux camarades au bord de la route, puis rejoignait ensuite la colonne.
Pendant ce temps à Coublevie, l’intérim fut assuré par M. Pierre Favet, adjoint au maire. Au cours du conseil municipal du 11 septembre 1944, le Comité Départemental de Libération National désigne :
- M. Joseph Brellier, 1er adjoint – M. Emile Revel, 2ème adjoint et quelques nouveaux conseillers et les installe dans leur fonction. Monsieur Brochier, absent, est maintenu en qualité de Maire. Le conseil municipal confirme ces nominations.
- Suivant le compte rendu du Conseil municipal du 18 mai 1945 entérinant les élections du 29 avril et du 13 mai 1945, Messieurs Brellier et Revel sont élus adjoints, M. Brochier, absent, est maintenu Maire.
- Le 28 juillet 1946, la mairie a reçu l’acte de décès de M. Brochier, disparu en Bavière en avril 1945, épuisé par ses souffrances.
- A la suite d’élections, Monsieur Joseph Brellier est élu Maire le 15 Août 1946 - M. Revel 1er Adjoint – M. Pierre Tivollier 2ème Adjoint.
- En Août 1948, la Place Ernest Brochier est inaugurée par M. Joseph Brellier Maire, en présence du Conseil Municipal, de Mme Veuve Ernest Brochier et de la population de Coublevie.
Un recueillement eut lieu au monument aux morts où figure le nom de M. Ernest BROCHIER.
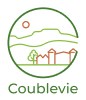
 Moyen
Moyen